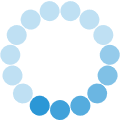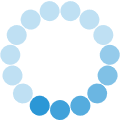Certains matins elle révise son emploi du temps
Imagine ce qu'elle doit faire et se dit... et puis non
Elle paresse
Au ralenti elle glisse de la cafetière à la fenêtre
Elle aimerait entendre un disque mais il faudrait le mettre
Et rien ne presse
Mademoiselle paresse à Paris
Elle traîne, elle pérégrine
Son altesse caresse aujourd'hui
L'idée d'aller à la piscine
Elle descend dans la rue, il est 16 heures, elle marche lentement
S'assoit sur un banc pour étudier le chemin le plus long
Le transport le plus lent
Le métro pourquoi pas mais y a pas de grève en ce moment
Quant au bus il est trop tôt pour être bloqué dans les bouchons
Alors à quoi bon
Le transport qu'elle préfère c'est la balançoire
On bouge d'avant en arrière en prenant du retard
Elle rallonge par la square
C'est la fermeture quand elle arrive au guichet
Elle s'en veut de rater de si peu, à quelques minutes prés
Un peu plus elle rentrait
Faut pas compter sur la chance, alors demain si elle jure
D'évaluer mieux les distances pour être bien sûr
D'arriver en retard
Sans rien devoir au hasard.
Voilà pour le premier texte maintenant le deuxième texte;
Brillat-Savarin, la Physiologie du goût (1826)
Le juriste Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826) n'est pas resté célèbre pour ses travaux sur le droit, mais pour un volume inclassable : La physiologie du goût.
Ce n'est pas un livre de recettes, même si, au détour des pages, on y apprend à cuisiner. Ce n'est pas non plus une autobiographie, même si l'auteur y raconte de nombreuses anecdotes concernant sa vie et ses voyages ( en Suisse et en Amérique notamment). Enfin, ce n'est pas un livre de sciences, bien que notre gastronome se proclame chimiste. C'est l'ouvrage d'un homme curieux de tout, incorrigible conteur qui se laisse aller à toutes les digressions possibles. Il n'est jamais aussi sérieux que lorsqu'il semble plaisanter, et jamais aussi pince-sans-rire que lorsqu'il paraît vouloir donner des leçons à ses contemporains. C'est aussi un grand styliste, qui manie notre langue comme personne. Dans cet extrait, Brillat-Savarin remarque qu'en politique, le détour par la gastronomie est un art de vivre autant qu'un art de faire : les grandes décisions se prennent à table.
INFLUENCE DE LA GASTRONOMIE DANS LES AFFAIRES
On sait que chez les hommes encore voisins de l'état de nature aucune affaire de quelque importance ne se traite qu'à table :c'est au milieu des festins que les sauvages décident la guerre ou font la paix; et, sans aller si loin, nous voyons que les villageois font toutes leurs affaires au cabaret.
Cette observation n'a pas échappé à ceux qui ont souvent à traiter les plus grands intérêts; ils ont vu que l'homme repu n'était pas le même que l'homme à jeun; que la table établissait une espèce de lien entre celui qui traite et celui qui est traité; qu'elle rendait les convives plus aptes à recevoir certaines impressions, à se soumettre à de certaines influences; de là est née la gastronomie politique. Les repas sont devenus un moyen de gouvernement, et le sort des peuples s'est décidé dans un banquet.
Ceci n'est ni un paradoxe ni même une nouveauté, mais une simple observation de faits. Qu'on ouvre tous les historiens, depuis Hérodote jusqu'à nos jours, et ou verra que, sans même en excepter les conspirations, il ne s'est jamais passé un grand évènement qui n'ait été conçu, préparé et ordonné dans les festins.
Voilà pour le deuxième maintenant voici le dernier;
Montaigne, Essais, "De la vanité" (1580-1595)
Chez Montaigne, nous l'avons vu, la pensée est exploration de "mille sentiers". Non seulement le monde est vaste et les sujets nombreux, mais aussi Montaigne a peu de certitudes - à part sa foi catholique qui doit plus au cœur qu'à la raison- et, il revendique le droit de changer d'opinion; avec quelques-uns de son siècle, il est l'un des premiers auteurs "relativistes".
Dans ses voyages, comme dans sa pensée et dans son écriture, il ne se laisse guider que par sa volonté, sa fantaisie et son ouverture d'esprit.
Il revendique pleinement le détour, dont il fait la règle de son rapport au monde.
["Moi, qui le plus souvent voyage pour mon plaisir"]
Et puis c'est à faire à ceux que les affaires entraînent en plein hiver par les Grisons, d'être surpris en chemin en cette extrémité.
Moi, qui le plus souvent voyage pour mon plaisir, ne me guide pas si mal. S'il fait laid à droite, je prends à gauche si je me trouve mal propre à monter à cheval, je m'arrête. Et faisant ainsi, je ne vois à la vérité rien qui ne soit aussi plaisant et commode que ma maison.
Il est vrai que je trouve la superfluité toujours superflue, et remarque de l'empêchement en délicatesse même et en l'abondance.
Ai-je laissé quelque chose à voir derrière moi, j'y retourne, c'est toujours mon chemin. Je ne trace aucune ligne certaine, ni droite ni courbe. Ne trouvé-je point où je vais ce qu'on m'avait dit - comme il advient souvent que les jugements d'autrui ne s'accordent pas aux miens, et les ai trouvés plus souvent faux - je ne plains pas ma peine, j'ai appris que ce que je disais n' y est point. J'ai la complexion du corps libre, et le goût commun, autant qu'un homme du monde : la diversité des façons, d'une nation à autre, ne me touche que par le plaisir de la variété. Chaque usage a une raison. Soient des assiettes d'étain, de bois, de terre, bouilli ou rôti, beurre ou huile de noix ou d'olive, chaud ou froid - tout m'est un. Et si un, que, vieillissant, j'accuse cette généreuse faculté et aurais besoin que la délicatesse et le choix arrêtât l'indiscrétion de mon appétit, et parfois soulageât mon estomac.
Quand j'ai été ailleurs qu'en France, et que pour me faire courtoisie on m'a demandé si je voulais être servi à la française, je m'en suis moqué, et me suis toujours jeté aux tables les plus épaisses d'étrangers. J'ai honte de voir nos hommes enivrés de cette sotte d'humeur, de s'effaroucher des formes contraires aux leurs.
Il leur semble être hors de leur élément quand ils sont hors de leur village : où qu'ils aillent, ils se tiennent à leurs façons, et abominent les étrangères.
Retrouvent-ils un compatriote en Hongrie, ils festoient cette aventure; les voilà à se rallier et à se recoudre ensemble, à condamner tant de mœurs barbares qu'ils voient. Pourquoi non barbares, puisqu'elles ne sont françaises ? Encore sont-ce les plus habiles qui les ont reconnues, pour en médire : La plupart ne prennent l'aller que pour le venir.
Ils voyagent ouverts et resserrés, d'une prudence taciturne et incommunicable, se défendant de la contagion d'un air inconnu.